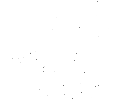Fichier
Jan-Fev-26_1.pdf6.56 Mo
Pitblad de Janvier - Février 2026
2025 se ferme, 2026 s’ouvre
Une page qui se tourne, un cahier qui s’ouvre.
Une page vierge à remplir, une tranche de vie à écrire, un
à-venir à vivre.
Les jours les plus courts sont passés, la lumière revient ;
la Lumière est déjà là, présente.
Avons-nous remarqué la Lumière ?
Dans les premiers jours de janvier, nous sommes encore
dans le temps béni de Noël. La naissance de Jésus, Em-
manuel, Dieu avec nous, à Noël, puis sa manifestation
au monde entier à l’Epiphanie, et enfin la déclaration
d’Amour du Père au Baptême, nous éclairent quant à la
volonté de Dieu sur le monde : en Jésus-Christ, donner
son Amour et sa Vie, pour que l’Homme soit libre pour
aimer lui-même.
Après le Baptême de Jésus commence le temps liturgique
dit ordinaire. Cette année, l’Evangile du dimanche qui
suit la célébration du Baptême de Jésus rapporte le té-
moignage de Jean le Baptiste : « moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ». Le temps ordi-
naire commence donc par l’invitation à reconnaitre Jésus
comme Fils de Dieu, et à se laisser accueillir chaque jour
par sa miséricorde : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde ».
Jésus-Christ, Lumière pour le monde.
Laissons-le éclairer la page vierge de cette année qui déb-
ute ; prenons notre vie comme un stylo et remplissons la
page 2026 avec les mots d’Espérance et les gestes de Foi
et d’Amour, animés par l’accueil de Dieu et du Prochain.
Et cela vise à être très concret : un mot d’encouragement,
un sourire, une visite, une carte à un(e) voisin(e), le souci
des immigrés, le souci des jeunes : il suffit d’écouter les
appels de notre cœur aimant.
A vous toutes et tous qui lisez ce petit mot, une très sainte
année 2026, à vivre dans la Joie et la Paix.
Ah ! n’oubliez pas : transmettez aussi ces vœux à tous
ceux qui vous entourent !
JMM Diacre
Soumis par Marc WATTEL le 3 janvier 2026